Les articles > Éloge du carburateur (une lecture pour les makers)
L’éloge du carburateur de Matthew B. Crawford est sans doute l’équivalent pour les makers de ce qu’est « la recherche” de Marcel Proust pour les chercheurs en littérature : le livre dont on doit savoir parler sans nécessairement l’avoir lu.
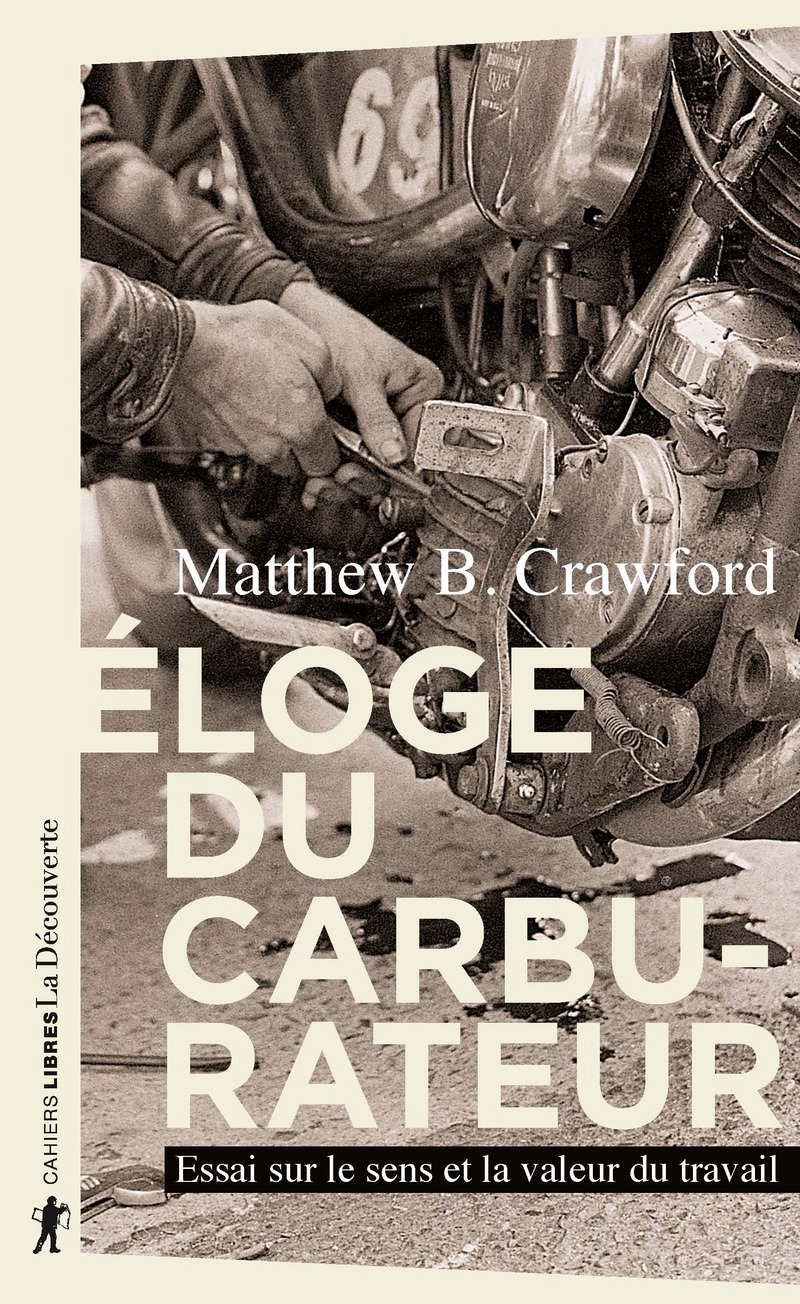
Pourquoi donc s’imposer cela…
L’Eloge du carburateur fait partie des très nombreux livres qui traînent dans mes étagères depuis de nombreuses années sans que je ne les ai encore lus. J’ai en effet pour habitude d’acheter périodiquement de très nombreux livres et de n’en lire qu’une infime proportion. Alors, pourquoi lire ce livre aujourd’hui ? Pour des raisons d’utilité professionnelle, certes. Mais aussi parce que je suis beaucoup plus habité depuis quelques années par la nécessité de donner du sens à ce que je fais et de vérifier que ce qui m’occupe professionnellement est en phase avec des valeurs que je sais nommer.
Pour commencer cette lecture, il fallait d’abord que je dépasse une certaine réticence de ma part : j’observe toujours avec un regard narquois ces nouveaux artisans, nouveaux agriculteurs, que l’on nous montre régulièrement dans les journaux télévisés. C’est d’ailleurs devenu un jeu : j’attends avec impatience et gourmandise le moment où l’interview de tel potier nouvellement installé dans le Luberon nous révèlera qu’il a choisi de quitter son poste dans la finance pour retrouver le goût des vraies choses. En commençant la lecture d’Eloge du carburateur, j’ai oublié rapidement mes réserves face à l’acuité des constats posés par Matthew B. Crawford et l’intelligence de son propos. Et pourtant, Matthew B. Crawford semblait correspondre parfaitement au profil si l’on en croit le résumé proposé par l’éditeur sur la quatrième de couverture : “Matthew B. Crawford était un brillant universitaire, bien payé pour travailler dans un think tank à Washington. Au bout de quelques mois, déprimé, il démissionne pour ouvrir… un atelier de réparation de motos”. En lisant le livre, on découvre rapidement que, certes, l’auteur se destinait à l’autoroute du système capitalistique mais que, dès ses plus jeunes années, il a dû cumuler divers emplois (d’électricien notamment) et des études en parallèle.
Tout le propos de l’auteur est, à partir du récit de sa propre expérience, de : questionner le sens et la valeur du travail ; et le relatif dédain que l’on a à l’égard des métiers manuels et à ceux qui les exercent. Il cherche par ailleurs à démontrer en quoi, dans une société de la consommation où l’on achète, jette et remplace, le fait de garder un contact avec le monde matériel reste plus que jamais une nécessité.
Pourquoi différencier faire et penser ?

Une première partie de l’ouvrage cherche les origines du relatif mépris que l’on observe depuis le XXème siècle à l’égard des métiers manuels. Crawford cite notamment The mind at work de Mike Rose “Nos éloges du travail manuel renvoient le plus souvent aux valeurs qu’il est censé incarner et non pas à l’effort de pensée qu’il requiert”.
Du point de vue de Crawford, cette vision résulte d’un effort délibéré du système capitaliste, qui s’est mis en place de manière progressive dans le système éducatif américain et dans les entreprises. Le taylorisme et le fordisme, en segmentant les opérations d’une chaîne de production, ont permis certes de gagner en productivité, mais ils ont eu aussi pour conséquence (voire pour raisons selon l’auteur) de démettre l’ouvrier de toute autonomie et de toute possibilité de penser et de développer des compétences. Le management scientifique a en effet pour but d’opérer une quasi-robotisation des ouvriers dont les tâches très limitées requièrent peu de compétences et donnent très peu de libertés. Tout le pouvoir étant transféré aux employeurs chargés de mettre en place les procédures et de s’assurer qu’elles sont respectées à la lettre. Cette nouvelle manière de travailler retire donc toute richesse cognitive au travail qui est réalisé. Selon l’auteur, ce processus, d’abord à l’œuvre dans l’industrie, s’est étendu par la suite au tertiaire et le développement de l’IA (que n’évoque pas l’auteur du fait de la date de publication de l’ouvrage) ne fera que parfaire ce processus.
Pourquoi les makers voient ce livre comme un très beau miroir ?
Au-delà des considérations sur ce que le capitalisme fait au monde du travail, le carburateur est très inspirant pour toute personne qui découvre le monde des makers. Crawford détaille au fil des pages des valeurs très structurantes pour les labs. On y retrouve notamment la “sainte trinité” des fablabs : l’utilité de l’apprentissage de pair à pair, par essais/erreurs et, évidemment, par le faire. Il détaille avec brio toute la richesse cognitive qu’implique une tâche manuelle et les nombreuses vertus morales qu’elle présente.
Tout d’abord, il souligne la perte de prise avec le monde réel qu’implique le développement croissant des “nouvelles technologies”. Or, selon lui, accomplir une tâche manuelle complexe, c’est une manière parfaite de sortir de soi-même et d’être présent au monde. Il faut observer, être recentré sur sa tâche, analyser et in fine agir.
Accomplir une tâche manuelle, c’est aussi une manière parfaite de critiquer le rapport au temps dans nos sociétés contemporaines. Paradoxalement, dans les sociétés occidentales, nous n’avons jamais disposé d’autant temps libre et nous avons pourtant le sentiment que celui-ci nous manque continuellement. Or, prendre le temps de réparer, c’est selon lui, une manière parmi d’autres de faire un pied de nez à ce sentiment d’urgence. C’est faire un choix qui n’est pas porté par un paradigme d’efficacité mais plutôt par celui de se donner du temps, de ralentir et, accessoirement, c’est souvent choisir une option plus écologique qu’un simple rachat de matériel.
Crawford est aussi critique à propos de la complexification constante du monde. Nous sommes de plus en plus entourés de technologies dont nous ne comprenons même pas les maillons essentiels. C’est par exemple le cas de la mécanique quantique. Et, à côté de cela, les industriels déploient des efforts constants pour rendre les interfaces qui nous mettent en contact avec ces machines ergonomiques et intuitives. Crawford, que l’on pourra peut-être qualifier d’esprit chagrin, considère face à cela “ que l’interface informatique ajoute une couche d’abstraction supplémentaire en dissimulant la logique humaine du programme qui régit le logiciel”. “L’interface […] prétend garantir le minimum de friction psychique entre l’intention de l’usager et sa réalisation”. Or, selon l’auteur, c’est justement ce type de résistance qui aiguise la conscience de la réalité. Le podcast Le code a changé de Xavier Delaporte avait dédié un épisode à ce sujet suite à la parution du livre Eloge du bug du philosophe Marcello Vitali Rosati.
Voici, parmi d’autres réflexions toutes aussi passionnantes, une partie des apports que la lecture de ce livre brillant pourra apporter à son lecteur.
Simon LEBRETTE
apprenant du Diplôme Universitaire Fabmanager, technique de facilitation et de fabrication numérique, promo #15
